Khalil Diouf — Le retour aux origines
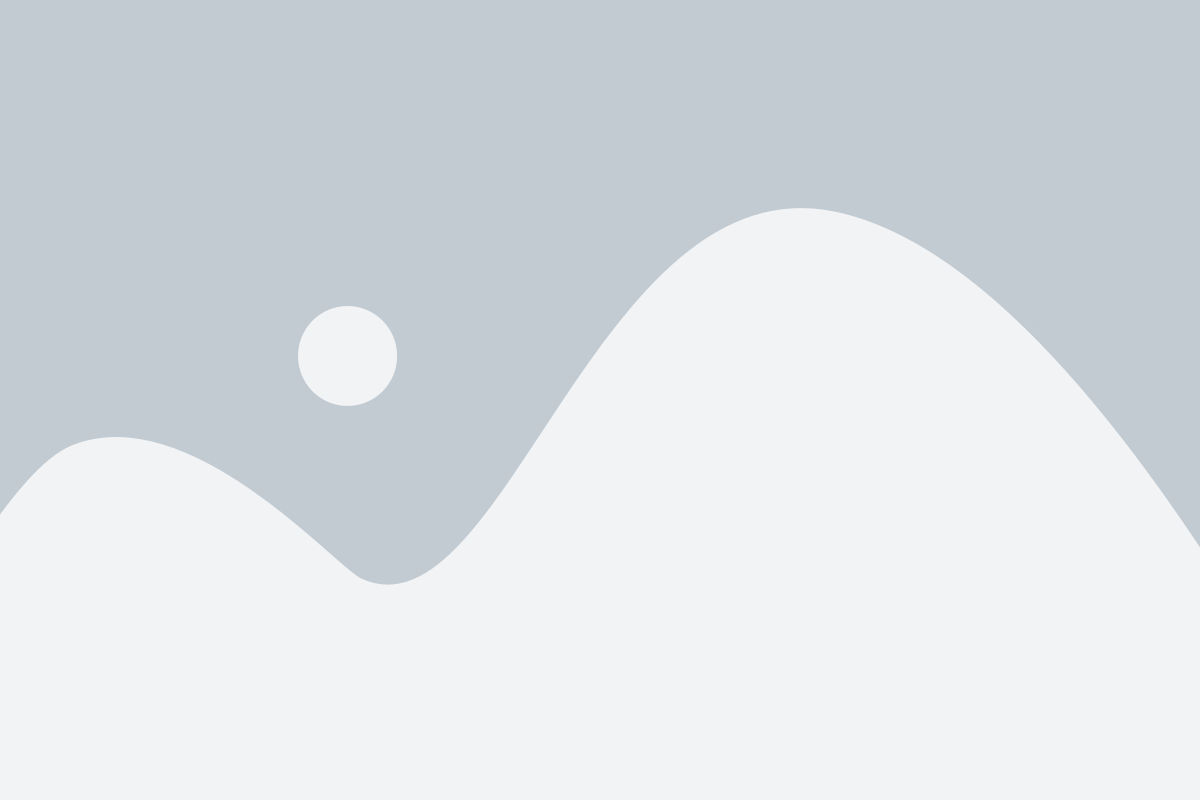
Khalil Diouf
« Mesdames et messieurs, nous entamons notre descente vers Dakar. Veuillez redresser vos sièges, relever vos tablettes… »
La voix de l’hôtesse s’élève dans le calme crépusculaire de la cabine, douce, presque irréelle. Elle me tire de ma torpeur. Mes doigts sont posés sur l’accoudoir, mes yeux rivés au hublot. Là, dans le lointain, le continent africain s’approche à vue d’aile. Dakar. Son ciel rougeoyant, sa poussière en suspens, ses lumières déjà prêtes à scintiller dans la pénombre du soir. Mon cœur cogne, discret mais insistant. Je rentre. Pour de bon.
Je ferme les yeux un instant. Tant d’années se sont écoulées depuis ce vol aller qui m’avait emporté, jeune étudiant ambitieux, vers Paris. J’étais parti après le bac, presque en courant, avec l’assurance irréfléchie de ceux qui croient que le monde les attend. Mon père m’avait tout préparé : billets, logement, même les chemises repassées. Il n’y avait qu’à partir. Je n’ai jamais été difficile, mais j’étais fier, insolent, parfois trop sûr de moi. Les filles m’entouraient, j’aimais ça. C’était facile. Mais parmi elles, une seule a marqué un territoire dans ma mémoire : Fatima Fall. La fille de ma tante Rokhaya. Une histoire douce et maladroite, un amour d’adolescents, d’autant plus précieux qu’il était fragile. Ma mère s’en réjouissait. Elle nous imaginait déjà mariés, main dans la main, dans la continuité de la tradition. Mais le temps, la distance, les egos… tout s’est délité. Et aujourd’hui, ce n’est plus qu’un souvenir, une image polie par les années.
Mais ce que j’ai toujours su préserver, c’est mon amitié indéfectible avec mes deux frères d’âme : Malick Faye, mon meilleur ami, et Mamadou Samb, le fils de notre gouvernante, Ndeye Marie. Elle m’a élevé comme l’un des siens, sans jamais réclamer plus qu’un sourire ou un merci. Mamadou, lui, venait chaque été à la maison, même s’il vivait chez sa grand-mère. Mon père l’a toujours considéré comme son propre fils, au point de financer ses études sans jamais broncher. Ma mère, elle, n’a jamais compris cette affection pour « le fils d’une domestique ». Mais moi, je savais. Une maison ne tient debout que grâce à ceux qui en balayent les ombres.
L’avion se pose. Les roues embrassent la terre, et dans mon ventre, tout se contracte. Je suis prêt, je crois. Prêt à recommencer ici. Je traverse le hall de l’aéroport, les valises à la main, le cœur dans la gorge. Et puis je le vois. Mon père. Grand, droit, élégant, avec ce sourire qu’il réserve à ceux qu’il aime vraiment. Il m’attend devant les portes vitrées, bras ouverts. Je m’y jette comme un enfant. Il sent le sable chaud, la stabilité, la fierté retenue.
— Mon fils. Enfin à la maison.
— Tu m’as manqué, papa.
— Toi aussi. Allez, viens. On a tant de choses à se dire.
Dans la voiture, tout revient naturellement. Nos conversations reprennent le fil, comme si je n’étais parti que la veille. Nous parlons de tout, surtout du travail. Il dirige BD Universal Auto, une entreprise florissante dans le secteur automobile. Il m’imagine à sa place, un jour. Mais moi, j’ai d’autres rêves pour commencer. J’ai lancé un projet à Richard-Toll : un domaine agricole, moderne, durable. L’agriculture m’apaise. Elle m’ancre. Et si tout fonctionne comme prévu, je pourrais devenir l’un des fournisseurs principaux de Teranga Agro. Une alliance solide, stratégique.
Le paysage défile. Les rues de Dakar, toujours encombrées, toujours vivantes. Le ciel est orange, dense. Nous arrivons enfin aux Almadies. La maison familiale est restée fidèle à mes souvenirs : vaste, impeccable, chaleureuse. Le portail s’ouvre. Mon cœur aussi.
Ma mère m’attend dans le salon. Robe droite, foulard ajusté, parfum discret. Elle ne sourit pas tout de suite, mais ses yeux brillent.
— Mon fils… te voilà enfin.
— Maman… je suis là.
Je la prends dans mes bras. Elle se retient de pleurer. Elle ne pleure jamais. Trop fière. Trop contenue. Mon père nous observe avec tendresse.
— Ton fils est revenu. Tu peux respirer maintenant, dit-il en plaisantant.
Et puis, derrière elle, une silhouette que je reconnaîtrais entre mille : Ndeye Marie. La loyauté incarnée.
— Bon garçon, t’es rentré pour de vrai, cette fois ?
— Tata Ndeye, tu m’as manqué.
— Toi aussi. Et ton frère Mamadou ne sait même pas que t’es là. Il aurait déjà campé devant la porte.
— Je leur fais une surprise. Malick aussi.
— Va te changer. Tu dois être fatigué. On mange dans une heure, dit ma mère avec autorité.
Je monte. Ma chambre, mon antre, n’a pas bougé. Deux pièces, un petit salon privé, des draps repassés. Une odeur d’encens flotte encore. Je prends une douche longue, silencieuse. J’enfile un jogging. Je déballe mes affaires. J’ai ramené des cadeaux pour tout le monde : des montres, des parfums, des livres… même pour Ndeye Marie. C’est la moindre des choses.
Quand je redescends, la table est dressée comme dans mon enfance. Mon père à sa place, ma mère face à lui. Ndeye Marie assise à côté. Chez nous, malgré le titre de « domestique », elle a toujours eu une chaise.
— Qui a préparé ce plat ? C’est incroyable !
— C’est la nouvelle cuisinière. Ousseynatou, dit Ndeye Marie.
— Ousseynatou… Quel joli prénom. Elle cuisine comme une cheffe, dis-je en riant.
Je savoure chaque bouchée. Cette cuisine a le goût d’un accueil. Un goût de tendresse anonyme.
— Alors, Khalil, tu prends la tête de l’entreprise maintenant ? demande ma mère.
— Non, pas tout de suite. Je veux me concentrer sur mon domaine agricole d’abord. Laisser papa respirer un peu plus longtemps.
Elle fronce légèrement les sourcils, mais ne dit rien. Mon père approuve d’un hochement de tête. Le dîner est agréable. Paisible. Il ne manque que ma sœur, Mberry, que je verrai demain. Maman organise un dîner en mon honneur. J’aurais préféré quelque chose de plus simple, mais je ne discute pas. Elle y tient.
Je monte chercher une veste. Je veux voir Malick ce soir. Trop d’années, trop de choses à dire. Je suis encore engourdi du voyage, alors j’appelle le chauffeur. Ma mère, fidèle à elle-même, me rattrape avant que je franchisse la porte.
— Khalil, tu viens à peine d’arriver, et déjà tu sors ? Tu ne vas pas recommencer à courir après toutes les filles, j’espère ?
— Maman… Je vais juste voir Malick.
— Très bien. Mais demain, on parle. Et pas de fuite.
Je l’embrasse, promets, m’échappe.
**
Malick ouvre la porte, en tee-shirt froissé, l’air soucieux. Mais en me voyant, son visage s’éclaire comme un matin d’été.
— Mon frère ! Tu n’as même pas prévenu !
— Je voulais faire une vraie surprise. Je suis là pour de bon.
Il hésite.
— Tu veux bien qu’on sorte un peu ? La maison n’est pas… idéale pour parler.
Nous marchons jusqu’à un coin tranquille, à quelques rues de là. La nuit est douce. Il reste silencieux un instant, puis lâche enfin :
— C’est encore ma mère. Elle… elle est allée trop loin cette fois.
Je l’écoute, sans parler. Je sens déjà la douleur monter dans sa gorge.
— Tu te souviens d’Absa ? Ma cousine, venue de Saint-Louis pour ses études ?
— Bien sûr. Jolie, discrète. Pourquoi ?
— Elle a organisé notre mariage. En douce. Sans m’en parler.
— Quoi ?
— Elle affirme qu’Aïcha est stérile. Et que je dois avoir un héritier. Elle veut que je prenne Absa comme seconde épouse.
Je reste muet. C’est trop absurde pour être vrai. Et pourtant…
— Aïcha est dévastée. Elle l’aimait comme une sœur. Elle lui a ouvert sa maison, son cœur… Et voilà comment on la remercie.
Malick baisse les yeux, écrasé par la honte.
— Elle me dit que c’est mon droit. Que si Aïcha ne peut pas me donner d’enfant, c’est légitime. Elle veut un petit-fils. À tout prix.
Je le prends dans mes bras. Mon frère. Mon ami. Écrasé par les attentes d’une mère aveuglée par le sang.
Et en moi, une pensée gronde, sourde, amère.
Quand apprendront-elles à nous laisser choisir ?
À aimer librement ? À écrire nos vies ?
